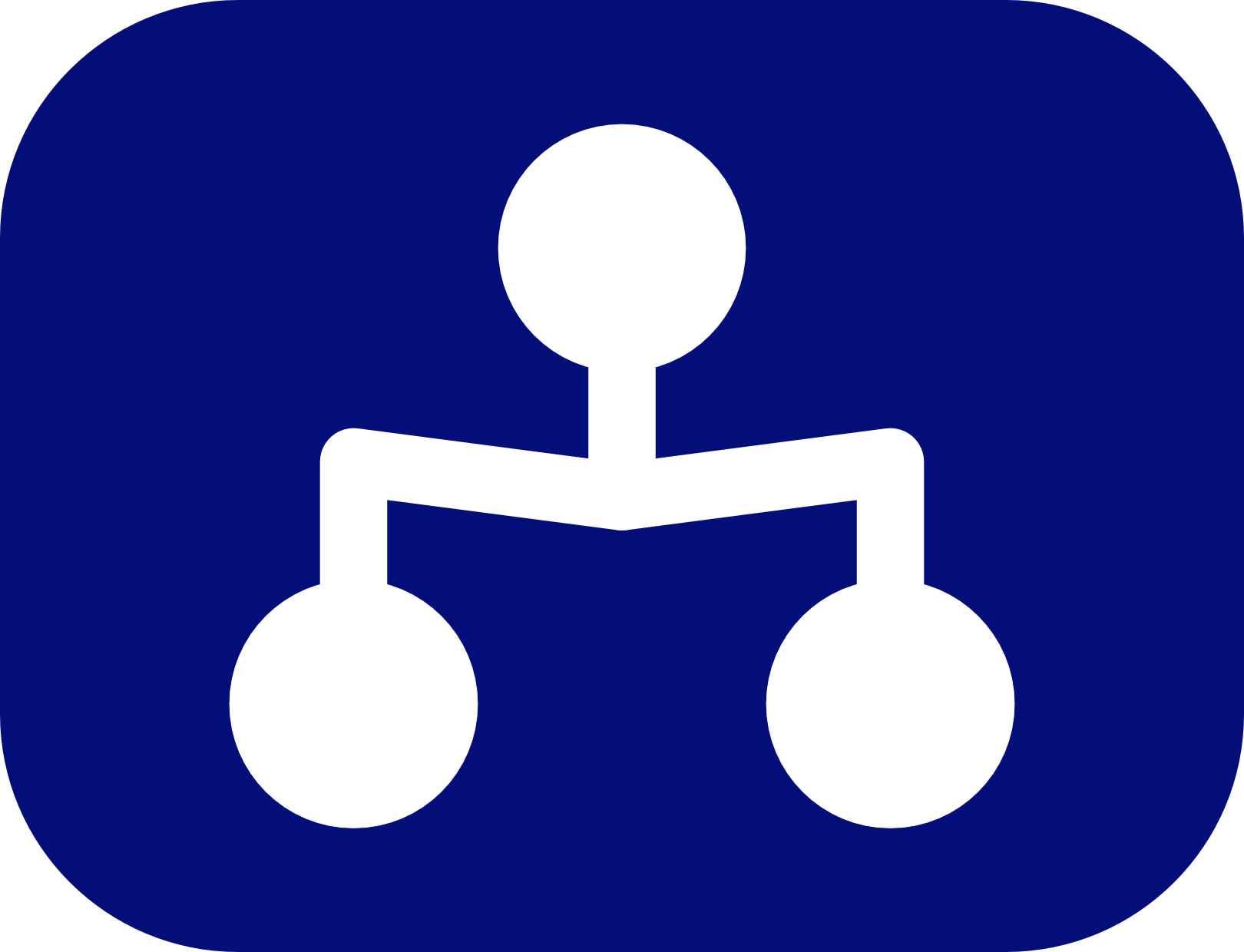Lorsque la médiation a été introduite dans le système judiciaire, avec l’inscription de la médiation dans le code de procédure, elle l’a été sans véritable définition. On peut néanmoins penser que, puisque les premiers développements de la médiation en tant que processus spécifique, structuré et bien identifié, venu des pays anglo saxons, se font en matière familiale, c’est sur la base de ces pratiques que son introduction a été voulue.
Cependant, l’internationalisation des influences dans notre société, le regard que nous portons sur l’expérience du droit dans l’Union européenne contribue à brouiller la notion de médiation et sa distinction avec d’autres techniques de règlement amiable des différends et le foisonnement actuel des MARD, ou MARL ou encore MARC.
Si les médiateurs s’entendent, à peu prêt sur la définition de leur activité en suisse romande, dans la pratique, les nuances, les approches et les philosophies peuvent varier parfois de manière importante quand on considère l’exercice à l’échelle nationale. En outre, vous aurez beaucoup de peine à trouver des définitions identiques pour expliquer les différences qui existent entre le travail d’un ombudsman (qui veut dire médiateur en suédois), d’un conciliateur et d’un médiateur.
On peut également relever que certaines nuances, pas toujours anodines, existent quand on examine l’interprétation que les médiateurs font de certains aspects du code de déontologie de la profession. Quand ces aspects sont soulevés dans le cadre associatif entre membres, les discussions ne manquent pas de piquant.
Y-a-t’il la place pour une discussion pour que certaines questions concernant l’étique ne soient plus sujettes à interprétation?